
A l’origine, en 1889, 600 pages d’un essai touffu, acheminé de digressions en exemplifications presque gratuites, confus pour tout dire, qui dérouta en son temps ses lecteurs. D’analogies en connexions, de l’agriculture au Moyen Âge au style de Zola, Simmel a voulu construire non pas une magistrale thèse sur la valeur, mais en éclairer le terrain, sinon le terreau, pour au final démontrer qu’en réalité, l’usage de l’argent n’avait qu’un seul but : faire l’économie d’une réflexion sur la valeur des choses et des êtres. L’argent, nous dit Simmel, ne sert qu’à faire l’économie de la prise de conscience des vraies valeurs, en réduisant les valeurs qualitatives à des chiffres, des nombres, du quantitatif. Inodore, incolore, c’est un moyen qui est devenu une fin, qui plus est, à prétention salvatrice. Mais l’argent ne sauve de rien, au contraire : il n’a cessé de nous enfoncer dans la marchandisation de la vie, de toute vie à la surface de la planète, des biens tout autant que des êtres. L’argent n’a cessé de nous corrompre pour reprendre le vocabulaire des Lumières, faisant disparaître dans sa finalité les causes de toute chose. Au point que la question n’est plus de savoir quelle est la valeur de ces choses, mais combien elles coûtent. L’argent dans la culture moderne, écrivait Simmel en 1896, c’est ce que l’on pouvait redouter de plus vulgaire dans le processus d’acculturation de l’humanité : parce que l’argent n’a fait que sanctionner notre renoncement aux vérités, introduisant jusqu’au plus profond du processus de pensée la mécanique sournoise du mensonge et de la propagande.
Psychologie de l’argent, Georg Simmel, éditions Allia, traduit de l’allemand par Alain Deneault, 78 pages, 7 euros, ean : 9791030410266.



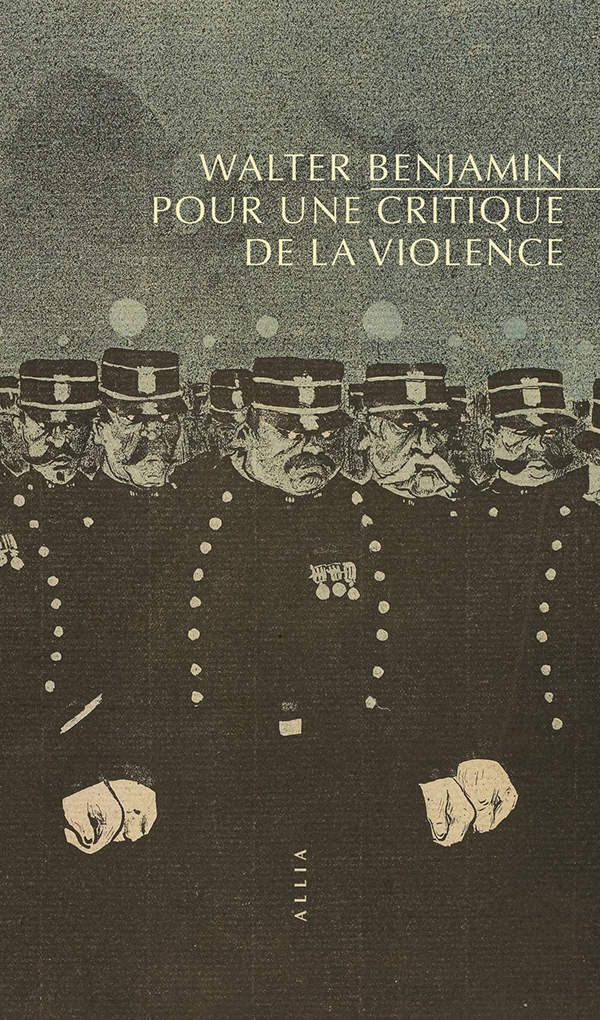


/image%2F1527769%2F20160610%2Fob_c0523d_patrick-tort.jpg)
/image%2F1527769%2F20150705%2Fob_6a9c2c_les-armeniens.jpg)