
Une pièce que Camus admirait, dénonçant la sauvagerie de la répression espagnole : «Il fallait dégoûter à jamais un peuple de la révolution»… On voit bien comment fonctionnent toutes ces dictatures qui avancent masquées ou non, un discours mensonger aux lèvres, la force des armes répressives en bandoulière, ainsi qu’il en va dans la France de Macron par exemple. Venezuela, juillet 1812. Simon Bolivar est en fuite. La répression s’abat, monstrueuse. Montserrat est révolté par les massacres perpétrés contre le peuple. Lui, haut dignitaire de l’état, se refuse à fuir alors qu’on l’en presse dans son entourage. Littéralement, les forces de répression agissent envers les indiens comme s’ils n’étaient que du bétail. Mais la répression veut mettre la main sur Bolivar. Six otages ont été capturés. Leur vie dépend des réponses que Montserrat apportera pour permettre la capture de Bolivar. Dans l’Acte II, Montserrat est seul, confronté aux otages qui le pressent de livrer Bolivar. Il a beau leur expliquer qu’il est de leur côté, bien évidemment, ces derniers ne veulent pas mourir et le somment de livrer Bolivar. A la fin de la scène, les otages veulent le tuer pour se libérer de ce chantage. Izquierdo, l’Inquisiteur, sauve Montserrat et fait exécuter un potier. Puis un marchand, puis un comédien après exigé de lui qu’il joue son propre rôle. Puis une mère de famille. Montserrat est sur le point de céder. L’une des otages, Eléna, l’en interdit. Elle est la vraie héroïne de la pièce, elle, sans nom, sans vie, sans horizon, humble parmi les humbles, femme du peuple, préférant se sacrifier plutôt que de subir la domination abjecte des espagnols. En quoi Montserrat nous concerne ? Camus n’a cessé d’y songer, articulant essentiellement son propos à la figure de Montserrat, dans l’oubli d’Eléna. D’elle, je retiendrai que le désespoir est la certitude du néant et qu’on ne peut lui céder. D’elle, femme du peuple, je retiendrai que la vérité des puissants est honteuse, qui ne sait que bafouer les Droits de l'Homme et mutiler les êtres humains, les éborgner, les estropier. D’elle, je retiendrai que les témoignages irréfutables des victimes sont la force d’un monde autre déjà, le seul digne d’être proclamé humain. Dans la (f)Rance de Macron, aujourd’hui, «il faut dégoûter à jamais le peuple de la révolution», de la justice, de la dignité. Nous sommes précisément dans cet espace de sacrifice et d’otages que Montserrat décrit, où la trahison des élites protège une idée vile de l’homme.
Emmanuel Roblès, Montserrat, Livre de poche n°2570, 158 pages, 5.30 euros, ean : 9782253003533.








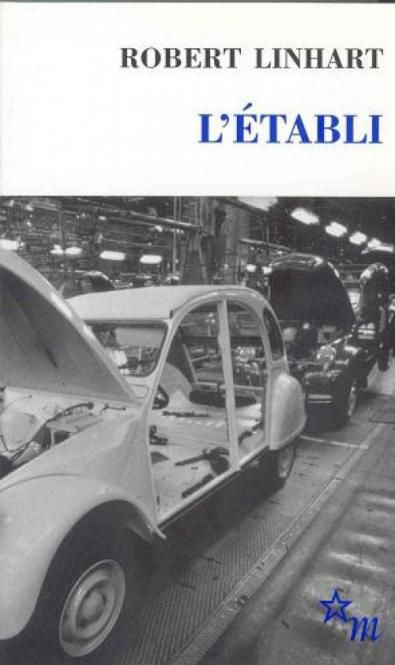

 Hier soir, sur la scène des EMA, à Vitry-sur-Seine, Bouziane Bouteldja, en résidence au théâtre Jean Vilar et aux EMA et dans le cadre de la semaine de la danse organisée par la ville de Vitry, à laquelle s’est associée la Briqueterie, a proposé un spectacle proprement ahurissant, mélangeant hip-hop et danse classique avec ses élèves de la section danse du lycée Citroën de Paris et ceux du conservatoire de danse classique des EMA de Vitry, avant de clore la session par un solo d’une puissance souveraine : Réversible. La colère, tel était le thème autour duquel ses élèves avaient travaillé. Imaginez alors cette colère essaimant sous la chorégraphie d’ordinaire évanescente de la danse classique ! Colère rentrée pour les uns, froide, explosive pour les autres, en discrétion, en disruption en irruption, interprétée avec une élégance et une force inattendue par ces jeunes danseurs, démultipliée bientôt par la violence festive du hip-hop avant de brûler, littéralement, dans ce corps à corps effarant proposé par Bouziane. Déchirement, exaspération, supplique d’un corps bardé d’interdits par les religions révélées, s’arrachant, tel celui des esclaves de Michel Ange, chair à chair, aux entraves qui le brident. Corps meurtri, gommé, esseulé, ancré à des tonnes de pesanteurs, affecté, re-ligere (ce relié des religions qui n’embrasse aujourd’hui aucun sublime dirait-on) –mais pour le pire… Corps défait qu’il recommençait sans cesse, là, sous nos yeux, s’arrachant à lui-même, à son double incarcéré, à cette matrice inconvenante et obscène de l’égarement dans lequel les religions sont tombées. Corps furieux, aimant sinon aimé de nuées incapables d’apporter la paix sur la terre. Corps en déséquilibre constant, cherchant comme une proie son équilibre avant d’exploser en figure foudroyante. Quel spectacle, quelle puissance, quelle leçon !
Hier soir, sur la scène des EMA, à Vitry-sur-Seine, Bouziane Bouteldja, en résidence au théâtre Jean Vilar et aux EMA et dans le cadre de la semaine de la danse organisée par la ville de Vitry, à laquelle s’est associée la Briqueterie, a proposé un spectacle proprement ahurissant, mélangeant hip-hop et danse classique avec ses élèves de la section danse du lycée Citroën de Paris et ceux du conservatoire de danse classique des EMA de Vitry, avant de clore la session par un solo d’une puissance souveraine : Réversible. La colère, tel était le thème autour duquel ses élèves avaient travaillé. Imaginez alors cette colère essaimant sous la chorégraphie d’ordinaire évanescente de la danse classique ! Colère rentrée pour les uns, froide, explosive pour les autres, en discrétion, en disruption en irruption, interprétée avec une élégance et une force inattendue par ces jeunes danseurs, démultipliée bientôt par la violence festive du hip-hop avant de brûler, littéralement, dans ce corps à corps effarant proposé par Bouziane. Déchirement, exaspération, supplique d’un corps bardé d’interdits par les religions révélées, s’arrachant, tel celui des esclaves de Michel Ange, chair à chair, aux entraves qui le brident. Corps meurtri, gommé, esseulé, ancré à des tonnes de pesanteurs, affecté, re-ligere (ce relié des religions qui n’embrasse aujourd’hui aucun sublime dirait-on) –mais pour le pire… Corps défait qu’il recommençait sans cesse, là, sous nos yeux, s’arrachant à lui-même, à son double incarcéré, à cette matrice inconvenante et obscène de l’égarement dans lequel les religions sont tombées. Corps furieux, aimant sinon aimé de nuées incapables d’apporter la paix sur la terre. Corps en déséquilibre constant, cherchant comme une proie son équilibre avant d’exploser en figure foudroyante. Quel spectacle, quelle puissance, quelle leçon !