 Dans les années 20 paraissait, à Paris et Varsovie, en français et en polonais, une revue d'avant-garde -L'Art contemporain-, dédiée à la création artistique et littéraire européenne. Co-dirigée par des intellectuels polonais et parisiens, cette revue au format insolite (30x40 cm) offrit une tribune rare aux polonais de l'avant-garde d'alors, convoquant parfois écrivains et peintres dans des registres peu habituels (Chirico en rédacteur plutôt qu'en peintre, par exemple, voire Picasso dans le même emploi). Une revue attestant alors d'échanges nourris, donnant à comprendre combien le filtre polonais fut important dans ces années pour l'appréhension du périmètre européen.
Dans les années 20 paraissait, à Paris et Varsovie, en français et en polonais, une revue d'avant-garde -L'Art contemporain-, dédiée à la création artistique et littéraire européenne. Co-dirigée par des intellectuels polonais et parisiens, cette revue au format insolite (30x40 cm) offrit une tribune rare aux polonais de l'avant-garde d'alors, convoquant parfois écrivains et peintres dans des registres peu habituels (Chirico en rédacteur plutôt qu'en peintre, par exemple, voire Picasso dans le même emploi). Une revue attestant alors d'échanges nourris, donnant à comprendre combien le filtre polonais fut important dans ces années pour l'appréhension du périmètre européen. Toute l’avant-garde s’y pressa, fiévreuse des théories qui dominaient alors l’espace du débat artistique.
Toute l’avant-garde put ainsi se tenir au courant des débats polonais particulièrement riches sur les questions de la place de l’art et de la littérature dans la société.
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art, quelle est sa place dans le monde, voire sa fonction politique? Certains répondaient à la hâte, d’autres prenaient le temps de recenser les symptômes et de dénoncer la prolifération des "ismes" qui déferlaient alors et prétendaient dicter les canons de l’acte créateur.
Débats intenses, houleux, extraordinairement féconds du côté polonais, où l’on refusait à s’enfermer dans des positions par trop doctrinales.
Le cubisme, le dadaïsme, le futurisme, le constructivisme, le surréalisme, le formisme pour les polonais, un mouvement étonnant, jamais étudié en France, la revue passa ainsi au crible tout ce que l’Europe inventait, cherchant à débusquer l’émotion artistique, au risque de ses formes et de ses contenus, dans un monde que l’on pressentait alors déjà comme un décor encombrant.
Je voudrais juste ici rappeler cette mémoire. Anecdotiquement, a travers l’évocation paresseuse de deux personnalités du monde de l’art de cette période oubliées aujourd’hui et donner à entendre une voie critique, désuète par endroits, pertinente à d’autres, dans son mouvement d’humeur par exemple, contre la conception généalogiste de la création artistique et le rangement des artistes au sein des chronologies construites -et même si elle ne sait trop argumenter cette humeur, juste pour me rappeler combien l’exercice critique est délicat, périlleux, voire une forfanterie dont on ferait tout aussi bien de se passer…
"Louis Marcoussis, écrit ainsi dans le numéro 1 de la revue Waldemar George, défend avec témérité cette tradition du dandysme artistique, de l’aristocratie de la pensée et du geste, de l’élégance mentale et corporelle, dont le peintre Manet a été l’ultime représentant. (…) Et pourtant, Marcoussis n’est pas un peintre mondain. (…)
"Fleur d’une civilisation plusieurs fois séculaire, (…), ce Polonais installé à Paris depuis un quart de siècle, a fait ses études de droit à Varsovie".
 Cubiste, il fut volontiers cité dans la monographie sur Picasso publiée par André Lewel, comme l’un des tout premiers, sinon le premier à expérimenter cette forme d’expression picturale inspirée tout droit de l’art primitif des Tatras. L’occasion pour Waldemar de fustiger les critiques français qui ne se sont jamais penchés sur la question, et au-delà de celle des origines, l’occasion de vilipender les gloses généalogistes en matière d’histoire de l’art :
Cubiste, il fut volontiers cité dans la monographie sur Picasso publiée par André Lewel, comme l’un des tout premiers, sinon le premier à expérimenter cette forme d’expression picturale inspirée tout droit de l’art primitif des Tatras. L’occasion pour Waldemar de fustiger les critiques français qui ne se sont jamais penchés sur la question, et au-delà de celle des origines, l’occasion de vilipender les gloses généalogistes en matière d’histoire de l’art : "Il faut mettre fin à la légende des grands courants d’idées qui traversent l’univers et qui laissent leurs empreintes partout où ils accèdent. L’historien viennois Aloïs Riegl a démontré d’une manière décisive l’insanité de la doctrine de Semper, qui limitait nos fonctions créatrices à la solution des problèmes d’ordre technique, et qui présentait les artistes comme tributaires des matières que la nature mettait à leur portée. (…)
"Le cubisme était un continent sur le point d’être conquis. Il importe peu de savoir qui tient dans l’œuvre de cette conquête le rôle héroïque de Colomb (…).
Mais Waldemar n’en poursuit pas moins, dénonçant à juste titre cette histoire des arts que l’on ne cesse de nous écrire, et qui ne sait généralement mettre en série que des chronologies factices, ignorante d’autres influences qu’elle ne sait décrire.
Une ignorance qui l’aurait ainsi portée à voir en Marcoussis un "suiveur" moins talentueux qu’un Picasso, quand Marcoussis, "en plein cubisme analytique, tentait au contraire de rendre à l’élément frontal tout son ancien prestige."
Si bien qu’en "1928 Marcoussis tourne le dos au cubisme orthodoxe, au style ’école cubiste’, adopté par les deux hémisphères."
"(Mais) ce conflit entre l’élément plastique, entre le rythme propre à la construction de la beauté et une figuration magique et dramatique était perceptible dans la plupart de ses toiles. Or ce conflit a été aplani (par les cubistes officiels). (…)
"Marcoussis abandonne alors un mode qui comportait une interprétation de la réalité conforme, sinon aux apparences, aux lois régissant le mécanisme de l’œil, du moins à sa logique. Le cubisme n’est qu’un surnaturisme, une vision neuve des faits soumise à l’action d’une analyse ardente, une reconstruction de l’univers visible, un style elliptique susceptible d’être traduit en chiffres, connus de tous. (..)
"C’est (ainsi) en vain qu’on chercherait dans les tableaux que Louis Marcoussis livrera au public, lors de sa prochaine exposition, cette cadence organique qui liait les formes les unes aux autres et qui scellait l’unité de la surface. Point de sciures plastiques, basées sur des associations d'objets, voire d'images. (...)
"Une écriture tranchante, celle d’un homme qui énonce sa pensée avec force. Des formes à claire-voie que supporte une armature spatiale de plans opaques. (…)
"Marcoussis ne s’adresse désormais qu’à l’imagination. Devant ses toiles qui sont des mimogrammes, des formules rituelles ou des phrases musicales, il ne vient à l’idée de personne de songer à des problèmes posés et résolus. (…)
"Marcoussis refuse l’académisme, cette pierre d’achoppement des révolutionnaires, et brûle les théories de l’allitération. Au rythme formel il a substitué un mouvement figuré. A présent, il isole ses figures. Il transforme les rapports des surfaces en rapport d’espaces. Il émancipe les vides, les intervalles. Seule, la donnée poétique unifie son tableau. Elle en devient le principe, l’idée force. A l’empirisme et au rationnel il a préféré une forme sur laquelle l’expérience ne peut avoir aucune prise, une forme qui est une pure pensée créatrice, pure mode d’émotion, pure subjectivité."--joël jégouzo--.
Revue L'Art contemporain, rédaction : 21, rue Valette, Paris 5ème, n°1, Kilométrage 0, janvier 1929, cote FN 14608, BNF. Image : Marcoussis, Une bouteille de whisky et un paquet de scaferlati (1913), Huile sur papier marouflé sur toile (55 x 46). Marcoussis :La table (1930), Eau-forte (25 x 18). Nombre de tableaux de Marcoussis sont visibles au Musée de Dijon.
 Dans les années 20 paraissait, à Paris et Varsovie, en français et en polonais, une revue d'avant-garde -L'Art contemporain-, dédiée à la création artistique et littéraire européenne. Co-dirigée par des intellectuels polonais et parisiens, cette revue au format insolite (30x40 cm) offrit une tribune rare aux polonais de l'avant-garde d'alors, convoquant parfois écrivains et peintres dans des registres peu habituels (Chirico en rédacteur plutôt qu'en peintre, par exemple, voire Picasso dans le même emploi). Une revue attestant alors d'échanges nourris, donnant à comprendre combien le filtre polonais fut important dans ces années pour l'appréhension du périmètre européen.
Dans les années 20 paraissait, à Paris et Varsovie, en français et en polonais, une revue d'avant-garde -L'Art contemporain-, dédiée à la création artistique et littéraire européenne. Co-dirigée par des intellectuels polonais et parisiens, cette revue au format insolite (30x40 cm) offrit une tribune rare aux polonais de l'avant-garde d'alors, convoquant parfois écrivains et peintres dans des registres peu habituels (Chirico en rédacteur plutôt qu'en peintre, par exemple, voire Picasso dans le même emploi). Une revue attestant alors d'échanges nourris, donnant à comprendre combien le filtre polonais fut important dans ces années pour l'appréhension du périmètre européen.  Cubiste, il fut volontiers cité dans la monographie sur Picasso publiée par André Lewel, comme l’un des tout premiers, sinon le premier à expérimenter cette forme d’expression picturale inspirée tout droit de l’art primitif des Tatras. L’occasion pour Waldemar de fustiger les critiques français qui ne se sont jamais penchés sur la question, et au-delà de celle des origines, l’occasion de vilipender les gloses généalogistes en matière d’histoire de l’art :
Cubiste, il fut volontiers cité dans la monographie sur Picasso publiée par André Lewel, comme l’un des tout premiers, sinon le premier à expérimenter cette forme d’expression picturale inspirée tout droit de l’art primitif des Tatras. L’occasion pour Waldemar de fustiger les critiques français qui ne se sont jamais penchés sur la question, et au-delà de celle des origines, l’occasion de vilipender les gloses généalogistes en matière d’histoire de l’art : 




 Une Bella Donna se faisait élégante dans le miroir d’une banque italienne, occupant tour à tour sa place et une autre, invisible, laissant tantôt nos regards s’épuiser en vaine admiration, tantôt les sollicitant et suscitant l’œil qui cherche à voir et qui nous met en scène.
Une Bella Donna se faisait élégante dans le miroir d’une banque italienne, occupant tour à tour sa place et une autre, invisible, laissant tantôt nos regards s’épuiser en vaine admiration, tantôt les sollicitant et suscitant l’œil qui cherche à voir et qui nous met en scène. Peut-être référait-elle plus ou moins innocemment à un autre quelconque et imaginaire ce regard tout de même sexuel qu’elle qualifiait dans sa mise, et que pourtant, elle n’osait trop poser encore sur elle… Mais pour prendre qui et à quel piège ?
Peut-être référait-elle plus ou moins innocemment à un autre quelconque et imaginaire ce regard tout de même sexuel qu’elle qualifiait dans sa mise, et que pourtant, elle n’osait trop poser encore sur elle… Mais pour prendre qui et à quel piège ? Une Bella Donna se mirait dans les vitres de la Banca Monte dei Paschi, à Sienne.
Une Bella Donna se mirait dans les vitres de la Banca Monte dei Paschi, à Sienne. La Bella Donna se mirait. Il y avait une circularité dans son regard qui me fascinait. Une récursivité où s’arrimait le voir de l’autre, d’un autre qui l’aurait désirée, si belle, si délectable, dans cette élégance qu’elle construisait avec méthode, l’autre souverainement idéalisé, souverain désormais dans son altérité abstraite, créateur informel de ses formes, de cette grâce qu’elle dédiait provisoirement au miroir de la Banca Monte dei Paschi.
La Bella Donna se mirait. Il y avait une circularité dans son regard qui me fascinait. Une récursivité où s’arrimait le voir de l’autre, d’un autre qui l’aurait désirée, si belle, si délectable, dans cette élégance qu’elle construisait avec méthode, l’autre souverainement idéalisé, souverain désormais dans son altérité abstraite, créateur informel de ses formes, de cette grâce qu’elle dédiait provisoirement au miroir de la Banca Monte dei Paschi. Cloning Terror. W.J.T. Mitchell, théoricien de l’image, voit publier en France une série de réflexions qu’il a consacré à un phénomène sans précédent dans l’histoire de l’humanité : celui de la prolifération exponentielle des images de guerre dans l’imagerie publique des années 2001 – 2008, au point d’évoquer une véritable épidémie pictoriale. Une épidémie dont il serait impossible d’éradiquer les signes : car les images restent, sur internet, le vrai lieu de cette guerre nous dit Mitchell. Et elles y restent pour l’éternité en somme.
Cloning Terror. W.J.T. Mitchell, théoricien de l’image, voit publier en France une série de réflexions qu’il a consacré à un phénomène sans précédent dans l’histoire de l’humanité : celui de la prolifération exponentielle des images de guerre dans l’imagerie publique des années 2001 – 2008, au point d’évoquer une véritable épidémie pictoriale. Une épidémie dont il serait impossible d’éradiquer les signes : car les images restent, sur internet, le vrai lieu de cette guerre nous dit Mitchell. Et elles y restent pour l’éternité en somme. Cloning terror, une expression floue encore, que Mitchell construit jour après jour pour tenter de faire le pont entre deux phénomènes de société particulièrement centraux dans notre devenir historique : celui du clonage et celui du terrorisme, pour les relier, tenter d’en révéler l’unité profonde, rappelant que l’ère du terrorisme contemporain s’est ouverte en 2001, au moment où la recherche sur les cellules souches faisait l’objet d’un débat national aux States.
Cloning terror, une expression floue encore, que Mitchell construit jour après jour pour tenter de faire le pont entre deux phénomènes de société particulièrement centraux dans notre devenir historique : celui du clonage et celui du terrorisme, pour les relier, tenter d’en révéler l’unité profonde, rappelant que l’ère du terrorisme contemporain s’est ouverte en 2001, au moment où la recherche sur les cellules souches faisait l’objet d’un débat national aux States. Un building peut-il receler une opinion morale ? Peut-il porter une responsabilité sociale ?
Un building peut-il receler une opinion morale ? Peut-il porter une responsabilité sociale ? De Pétrarque à Goethe, la rencontre avec le paysage fut vécue comme une mise à l’épreuve des catégories de la pensée tout autant que de celles de l’écriture. Une foule d’auteurs fut prise d’inquiétude devant le surgissement de cet inconnu, traversé par la question qu’il posait à l’homme. Quelle question ? Celle de la violence contenue dans ce face à face nouveau au monde, que Simmel analysa par la suite comme témoignant du sentiment brusque de l’arrachement au Tout qui accompagna la longue gestation de l’individuation des formes de vie. La tragédie constitutive du paysage et de la modernité venait, là, se refléter, miroiter dans le regard des hommes sous la forme d’une partie d’un Tout devenant soudain un ensemble indépendant et revendiquant son droit face au Tout. C’est que le paysage induisait comme une sorte de restriction du monde visible au champ visuel. Hölderlin l’évoqua, construisant la figure de l’humain brusquement isolé dans la beauté du monde, faisant face sans trop savoir comment à la violence muette du paysage, autonome, mais débordant de ses abîmes.
De Pétrarque à Goethe, la rencontre avec le paysage fut vécue comme une mise à l’épreuve des catégories de la pensée tout autant que de celles de l’écriture. Une foule d’auteurs fut prise d’inquiétude devant le surgissement de cet inconnu, traversé par la question qu’il posait à l’homme. Quelle question ? Celle de la violence contenue dans ce face à face nouveau au monde, que Simmel analysa par la suite comme témoignant du sentiment brusque de l’arrachement au Tout qui accompagna la longue gestation de l’individuation des formes de vie. La tragédie constitutive du paysage et de la modernité venait, là, se refléter, miroiter dans le regard des hommes sous la forme d’une partie d’un Tout devenant soudain un ensemble indépendant et revendiquant son droit face au Tout. C’est que le paysage induisait comme une sorte de restriction du monde visible au champ visuel. Hölderlin l’évoqua, construisant la figure de l’humain brusquement isolé dans la beauté du monde, faisant face sans trop savoir comment à la violence muette du paysage, autonome, mais débordant de ses abîmes. Musée des Offices, Florence. Face au Sacrifice d’Isaac, de Caravage, Judith décapitant Holopherne. En écho. Aucun commentaire, juste ces deux tableaux qui se répondent. Non : un cartel pour nous apprendre que celui d’Artemisia fut remisé dans le recoin d’un palais jusqu’en 1777, soit pendant presque 165 ans. Parce que trop violent.
Musée des Offices, Florence. Face au Sacrifice d’Isaac, de Caravage, Judith décapitant Holopherne. En écho. Aucun commentaire, juste ces deux tableaux qui se répondent. Non : un cartel pour nous apprendre que celui d’Artemisia fut remisé dans le recoin d’un palais jusqu’en 1777, soit pendant presque 165 ans. Parce que trop violent.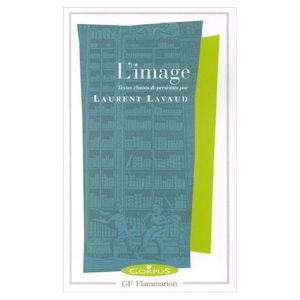 Entre discours savants, rappels philosophiques et propositions consensuelles, Laurent Lavaud tente de faire le point sur le statut de l'image, d’Aristote à Régis Debray. Manuel clair, convoquant l’essentiel des doctrines, il se présente un peu sous la forme d’un fichier pratique qui proposerait de multiples entrées, balayant le large spectre des interrogations que pose l’image. On peut ainsi le lire soit en suivant le fil de la double argumentation de son auteur, enracinant sa thématique dans l’histoire ; soit en le consultant au gré de ses interrogations, en s’appuyant sur une indexation croisée remarquable, soit encore en compulsant le vade-mecum, qui ré-articule l’ensemble en de courts résumés pertinents. Un livre intelligemment pensé, en somme. Le corpus des textes retenus est en outre établi avec assez de précaution pour répondre à la visée pédagogique de l’ouvrage. Il s’agit au fond de tout ce que l’on devrait savoir, juste avant d’entrer dans le débat contemporain. Avec le sentiment qu’il s’agit encore une fois de tout ce que l’on sait, en France... C’est justement le reproche que l’on peut adresser à l’auteur : d’ignorer les penseurs et les courants de pensée "étrangers" -W.J.T. Mitchell, Martin Jay, Homi Bhabha nous resteront inconnus. Corpus hexagonal donc, intéressant mais étriqué.--
Entre discours savants, rappels philosophiques et propositions consensuelles, Laurent Lavaud tente de faire le point sur le statut de l'image, d’Aristote à Régis Debray. Manuel clair, convoquant l’essentiel des doctrines, il se présente un peu sous la forme d’un fichier pratique qui proposerait de multiples entrées, balayant le large spectre des interrogations que pose l’image. On peut ainsi le lire soit en suivant le fil de la double argumentation de son auteur, enracinant sa thématique dans l’histoire ; soit en le consultant au gré de ses interrogations, en s’appuyant sur une indexation croisée remarquable, soit encore en compulsant le vade-mecum, qui ré-articule l’ensemble en de courts résumés pertinents. Un livre intelligemment pensé, en somme. Le corpus des textes retenus est en outre établi avec assez de précaution pour répondre à la visée pédagogique de l’ouvrage. Il s’agit au fond de tout ce que l’on devrait savoir, juste avant d’entrer dans le débat contemporain. Avec le sentiment qu’il s’agit encore une fois de tout ce que l’on sait, en France... C’est justement le reproche que l’on peut adresser à l’auteur : d’ignorer les penseurs et les courants de pensée "étrangers" -W.J.T. Mitchell, Martin Jay, Homi Bhabha nous resteront inconnus. Corpus hexagonal donc, intéressant mais étriqué.--