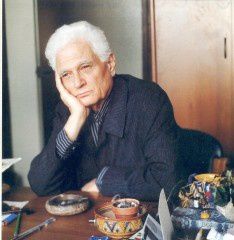 Quelques jours après la mort d’Emmanuel Lévinas, j’ai été chargé d’organiser une soirée, moins d’hommage que de veille, dans le souci que nous pouvions porter au grand homme disparu. Derrida était l’ami de Lévinas. Nous pensions le convier. Je l’ai appelé. Lui ai expliqué ce projet simple, d’être là, réunis au cœur de cette institution dont il avait été longtemps le Directeur, un établissement d’enseignement. Et puis je me suis tu, attendant la réponse de Derrida, qui m’avait écouté patiemment. Il ne m’a pas répondu tout de suite. J’entendais son souffle. Juste son souffle, l’oreille collée au combiné, me taisant à mon tour, attendant sa réponse. Derrida se taisait. Je n’entendais que son souffle. Un long moment comme ça, sans rien dire ni être tenté de briser ce silence. A quoi songeait-il, je n’en ai jamais rien su bien évidemment. Il se taisait, c’était tout. Pensait-il à quelque chose ou à rien, le regard tourné vers son for intérieur ou un objet quelconque sur son bureau, le combiné à l’oreille, sans dire un mot ? Quels détours le retenaient au seuil de livrer sa réponse ? Un souvenir, une image, le Visage enfui de Lévinas. Ou rien. Ne regardant plus rien dans ce poignant suspens du temps. Cela dura. J’entendais son souffle et je me taisais. Qu’est-ce qui justifie la pensée ? Je me suis rappelé Lévinas, que l’on croisait les dernières années dans cette institution qu’il avait dirigée. Affaibli, égaré parfois, ne se rappelant plus, avançant comme une ombre, reprenant un chemin qu’il avait si souvent pris, celui de son bureau, s’étonnant juste de ne plus le trouver à sa place. Ce n’était pas ça. Il ne savait plus. Alors on le raccompagnait affectueusement chez lui, à quelques pas de là, dans la même rue. Je me rappelais aussi les fulgurances de ces rencontres impossibles : alors qu’on croyait approcher un vieil homme perdu, soudain il vous interpellait : "Il faut relire Heidegger !".
Quelques jours après la mort d’Emmanuel Lévinas, j’ai été chargé d’organiser une soirée, moins d’hommage que de veille, dans le souci que nous pouvions porter au grand homme disparu. Derrida était l’ami de Lévinas. Nous pensions le convier. Je l’ai appelé. Lui ai expliqué ce projet simple, d’être là, réunis au cœur de cette institution dont il avait été longtemps le Directeur, un établissement d’enseignement. Et puis je me suis tu, attendant la réponse de Derrida, qui m’avait écouté patiemment. Il ne m’a pas répondu tout de suite. J’entendais son souffle. Juste son souffle, l’oreille collée au combiné, me taisant à mon tour, attendant sa réponse. Derrida se taisait. Je n’entendais que son souffle. Un long moment comme ça, sans rien dire ni être tenté de briser ce silence. A quoi songeait-il, je n’en ai jamais rien su bien évidemment. Il se taisait, c’était tout. Pensait-il à quelque chose ou à rien, le regard tourné vers son for intérieur ou un objet quelconque sur son bureau, le combiné à l’oreille, sans dire un mot ? Quels détours le retenaient au seuil de livrer sa réponse ? Un souvenir, une image, le Visage enfui de Lévinas. Ou rien. Ne regardant plus rien dans ce poignant suspens du temps. Cela dura. J’entendais son souffle et je me taisais. Qu’est-ce qui justifie la pensée ? Je me suis rappelé Lévinas, que l’on croisait les dernières années dans cette institution qu’il avait dirigée. Affaibli, égaré parfois, ne se rappelant plus, avançant comme une ombre, reprenant un chemin qu’il avait si souvent pris, celui de son bureau, s’étonnant juste de ne plus le trouver à sa place. Ce n’était pas ça. Il ne savait plus. Alors on le raccompagnait affectueusement chez lui, à quelques pas de là, dans la même rue. Je me rappelais aussi les fulgurances de ces rencontres impossibles : alors qu’on croyait approcher un vieil homme perdu, soudain il vous interpellait : "Il faut relire Heidegger !".
Derrida se taisait. A quoi prêter l’oreille ? J’entendais son souffle. Rien d’autre. Il était là, simplement, et j’ignorais s’il pensait ou non. Qu’est-ce que parler, quand on est Derrida ? Peut-être cherchait-il un moyen pour se défaire d’un appel qu’il jugeait incongru, ou bien réalisait-il la dissymétrie de cette relation désormais, Lévinas enfui dessous la terre. Peut-être l’émotion l’envahissait-elle, son ami enlevé, le bras ballant, la tête lourde soudain de tout ce temps qui les séparerait désormais. Peut-être cherchait-il un geste, un mot, un regard, tournant en vain les pages de ce vieux manuscrit qu’il ne savait plus déchiffrer : leur amitié achevée, là, dans la disparition de l’autre.
Derrida ne parlait pas. A quoi prêter l’oreille, quand on ne peut se rappeler l’écho du pas qui devrait retentir encore, quand cette voix s’est tue que l’on ne peut ranimer. J’avais évoqué des journées Lévinas, un rendez-vous à la Sorbonne, un colloque, des mémoires. Où reprendre leur parole exténuée ?
Au bout d’un long moment, Derrida a simplement dit qu’il ne pouvait pas. Qu’il était ailleurs. Encore un peu avec lui. Seul. J’entends encore sa voix. M’appartient-il aujourd’hui d’en exhiber le grain ?
Cette soirée a eu lieu. L’inévitable BHL avait fini par s’y convoquer. Lui, a parlé, longuement. Un éloge convenu, sans importance. Que communique le langage ? Cela a été ensuite publié. Ici et là. L’improvisation avait été soigneusement consignée. Derrida, lui, ne pouvait pas. Où commencer à dire ? Où commencer à écrire ? Où, plutôt que quand. Qu’y a-t-il du côté des choses muettes ? Où cela commence-t-il, écrire, que l’on pourrait ensuite mener ? --joël jégouzo--



 Ecrire engage au delà de ce que l’on peut imaginer. C’est que l’écriture travaille en un lieu que l’on ne saurait aisément circonscrire et dont l’on ne ressort pas sans quelque intranquilité, comme l’affirmait Pessoa... Car écrire est s’aventurer, aller, vers une rencontre incertaine loin des avances que la vie vous adresse dans la banalité de ses facondes quotidiennes. Une rencontre qui se fait pour ainsi dire par temps voilé, nulle part, un épais brouillard masquant d’abord la vue, des chimères, des ombres traversant le regard auxquelles il faut bien tout à la fois répondre, et résister. Où l’écriture nous donne-t-elle rendez-vous ?
Ecrire engage au delà de ce que l’on peut imaginer. C’est que l’écriture travaille en un lieu que l’on ne saurait aisément circonscrire et dont l’on ne ressort pas sans quelque intranquilité, comme l’affirmait Pessoa... Car écrire est s’aventurer, aller, vers une rencontre incertaine loin des avances que la vie vous adresse dans la banalité de ses facondes quotidiennes. Une rencontre qui se fait pour ainsi dire par temps voilé, nulle part, un épais brouillard masquant d’abord la vue, des chimères, des ombres traversant le regard auxquelles il faut bien tout à la fois répondre, et résister. Où l’écriture nous donne-t-elle rendez-vous ? Je n’ai parlé que très superficiellement de l’œuvre de Dostoïevski.
Je n’ai parlé que très superficiellement de l’œuvre de Dostoïevski. Dostoïevski, prétendaient les éditeurs français, avait la mauvaise habitude de ne jamais finir ses chapitres, ses paragraphes, ses phrases. Pire : au mépris de la grammaire russe, il infligeait à sa langue les plus invraisemblables dommages. Tout cela manquait de clarté, l’on ne pouvait, décidément, proposer à la lecture du public français une œuvre aussi inachevée. Et de raboter ici un grain trop rugueux et d’égaliser là... Sans rien comprendre en définitive à son œuvre, des éditeurs français ordonnèrent longtemps à leurs traducteurs de «finir» les phrases, les paragraphes, les chapitres, d’arranger ce style par trop «confus», bref, de rendre l’écriture de Dostoïevski conforme à l’exigence de clarté de l’esprit français, un esprit effrayé par cette écriture qui était un fleuve en crue charriant les mots sans ménagement, comme le gravier de vies perdues. En fin de compte, ce que l’on obtenait, c’était une œuvre fade qui résonnait joliment en français, mais qui avait perdu sa force, sa beauté, son étrangeté. Qu’était-ce donc, qui se déversait ainsi dans l’écriture de Dostoïevski et que l’esprit français ne pouvait recevoir ? Qu’y avait-il donc de si singulier dans cette écriture pour l’universalité du logos cartésien ?
Dostoïevski, prétendaient les éditeurs français, avait la mauvaise habitude de ne jamais finir ses chapitres, ses paragraphes, ses phrases. Pire : au mépris de la grammaire russe, il infligeait à sa langue les plus invraisemblables dommages. Tout cela manquait de clarté, l’on ne pouvait, décidément, proposer à la lecture du public français une œuvre aussi inachevée. Et de raboter ici un grain trop rugueux et d’égaliser là... Sans rien comprendre en définitive à son œuvre, des éditeurs français ordonnèrent longtemps à leurs traducteurs de «finir» les phrases, les paragraphes, les chapitres, d’arranger ce style par trop «confus», bref, de rendre l’écriture de Dostoïevski conforme à l’exigence de clarté de l’esprit français, un esprit effrayé par cette écriture qui était un fleuve en crue charriant les mots sans ménagement, comme le gravier de vies perdues. En fin de compte, ce que l’on obtenait, c’était une œuvre fade qui résonnait joliment en français, mais qui avait perdu sa force, sa beauté, son étrangeté. Qu’était-ce donc, qui se déversait ainsi dans l’écriture de Dostoïevski et que l’esprit français ne pouvait recevoir ? Qu’y avait-il donc de si singulier dans cette écriture pour l’universalité du logos cartésien ? Portugal : LEGENDE DU QUINT EMPIRE… (3/3)
Portugal : LEGENDE DU QUINT EMPIRE… (3/3) Portugal : LEGENDE DU QUINT EMPIRE… (2/3)
Portugal : LEGENDE DU QUINT EMPIRE… (2/3) Lagos, au Sud du Portugal. La statue de Dom
Lagos, au Sud du Portugal. La statue de Dom 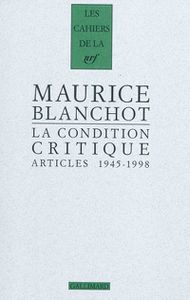 Les éditions Gallimard nous offrent, avec ce gros recueil d’articles, une récollection inédite des critiques publiées par Maurice Blanchot de 1945 à 1998. Critiques littéraires, études, textes à caractères théoriques et même quelques tirés à part.
Les éditions Gallimard nous offrent, avec ce gros recueil d’articles, une récollection inédite des critiques publiées par Maurice Blanchot de 1945 à 1998. Critiques littéraires, études, textes à caractères théoriques et même quelques tirés à part.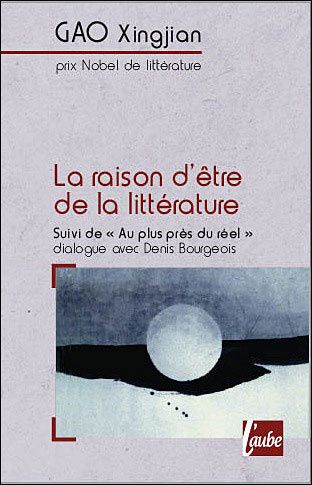 Les éditions de l’Aube ont réédité en 2008 le discours prononcé par le Prix Nobel de Littérature, le 7 décembre 2000. Un discours mesuré, qui s’efforçait surtout, contre ce que Gao Xingjian nommait le fléau de l’engagement, d’affirmer «la voix d’un individu». Ce qu’il fallait comprendre par là, l’entretien qui suivait le précisait. Nourri de l’œuvre de Gombrowicz, qu’il citait à de multiples reprises, Gao Xingjian refusait de mettre la littérature au service d’autre chose que d’elle-même, quel qu’en fut le prix à payer. Et le Prix Nobel de Littérature de stigmatiser, comme conséquence nécessaire de la position qu'il défendait, la "frustration" du monde occidental, plus attentif aux conséquences politiques de la réception de son œuvre en Chine, qu’à son travail d’écrivain. Cela dit, tout ne paraissait pas aussi clair dans son esprit. Dans la hiérarchie qu’il construisait, Gao Xingjian plaçait certes l’écriture au-dessus de la littérature, mais ne lui reconnaissait pour seule valeur que celle de «la vie». L’écriture fonctionnait ainsi sur le modèle romantique conventionnel, comme pure consolation si l'on veut, tout en restant soumise au vieux principe de réalité. Détachée du devoir de prétendre dire d'une quelconque manière le monde, mais lige de ses réalités... La quête de l’écrivain dès lors, ne cessait d’être, à ses yeux, celle du «réel», sans que l’on sût jamais ce qu’il fallait mettre sous ce vocable. De fait, l’écrivain oscillait-il lui-même entre l’amertume du dernier Mallarmé et l’enthousiasme de l’aventure proustienne. D’un côté l’écueil de l’art pour l’art (expression à laquelle le contraignait inopportunément son dialogue avec Denis Bourgeois), de l’autre une mystique de la litérarité que ce dialogue ne parvint jamais à dessiner. Une suite à ce dialogue aurait été heureuse, mais elle ne vint jamais…
Les éditions de l’Aube ont réédité en 2008 le discours prononcé par le Prix Nobel de Littérature, le 7 décembre 2000. Un discours mesuré, qui s’efforçait surtout, contre ce que Gao Xingjian nommait le fléau de l’engagement, d’affirmer «la voix d’un individu». Ce qu’il fallait comprendre par là, l’entretien qui suivait le précisait. Nourri de l’œuvre de Gombrowicz, qu’il citait à de multiples reprises, Gao Xingjian refusait de mettre la littérature au service d’autre chose que d’elle-même, quel qu’en fut le prix à payer. Et le Prix Nobel de Littérature de stigmatiser, comme conséquence nécessaire de la position qu'il défendait, la "frustration" du monde occidental, plus attentif aux conséquences politiques de la réception de son œuvre en Chine, qu’à son travail d’écrivain. Cela dit, tout ne paraissait pas aussi clair dans son esprit. Dans la hiérarchie qu’il construisait, Gao Xingjian plaçait certes l’écriture au-dessus de la littérature, mais ne lui reconnaissait pour seule valeur que celle de «la vie». L’écriture fonctionnait ainsi sur le modèle romantique conventionnel, comme pure consolation si l'on veut, tout en restant soumise au vieux principe de réalité. Détachée du devoir de prétendre dire d'une quelconque manière le monde, mais lige de ses réalités... La quête de l’écrivain dès lors, ne cessait d’être, à ses yeux, celle du «réel», sans que l’on sût jamais ce qu’il fallait mettre sous ce vocable. De fait, l’écrivain oscillait-il lui-même entre l’amertume du dernier Mallarmé et l’enthousiasme de l’aventure proustienne. D’un côté l’écueil de l’art pour l’art (expression à laquelle le contraignait inopportunément son dialogue avec Denis Bourgeois), de l’autre une mystique de la litérarité que ce dialogue ne parvint jamais à dessiner. Une suite à ce dialogue aurait été heureuse, mais elle ne vint jamais…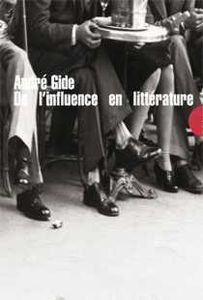 De l’imitation des maîtres en fait, non du plagiat -par exemple.
De l’imitation des maîtres en fait, non du plagiat -par exemple.