 La transmission des inégalités est, depuis 30 ans, la norme française, sinon son exception.
La transmission des inégalités est, depuis 30 ans, la norme française, sinon son exception.
7 enfants de cadres sur 10 exercent un emploi d’encadrement, quelques années après la fin de leurs études.
7 enfants d’ouvriers sur 10 occuperont toute leur vie un emploi sous-qualifié.
10% des français les plus riches concentrent 50% de la totalité des richesses connues en France. Non des richesses disponibles : ce calcul ne tient pas compte de l’argent placé dans les paradis fiscaux…
Les hauts revenus s’envolent en France et ce, depuis le début des années 2000.
La pauvreté, elle, s’étend : il y a 8 millions de pauvres en France, et ce volume croît de jour en jour.
Depuis 30 ans, l’ascenseur social est en panne en France. Mieux : les conditions de naissance déterminent plus que jamais le destin des individus.
L’école française républicaine ? Un échec. Connu. Décortiqué. Mieux : une agence de sélection destinée à produire de l’exclusion, pointée du doigt par l’OCDE pour ses mauvais résultats qui la classe dans les derniers rangs de la lutte contre les inégalités.
Un exemple ? Tout le poids de la dépense scolaire est concentré en France sur les filières prestigieuses : grandes écoles, filières élitistes des universités sélectives, classes prépas, lycée généraux d’excellence. La Nation paie très cher le coût des études de ses enfants… les plus favorisés ! Curieuse conception de la solidarité nationale…
Dans ce système les enseignements les plus fondamentaux, là où tout se joue et là où les efforts devraient être les plus importants, dans les classes maternelles et du primaire, l’OCDE observe que de tous les pays avancés, la France est celle qui dépense le moins d’argent et leur a affecté le moins de moyens humains et matériels.
Le destin des petits français est ainsi, études à l’appui, scellé très tôt, en primaire généralement.
La réalité sociale française est désormais celle du déclassement. Le parcours des jeunes d’aujourd’hui, fortement lié aux ressources économiques de leurs parents, traduit à la perfection cette réalité hallucinante.
Une réalité dont la classe politique refuse de prendre la mesure, préférant parler de crise, comme si la société était malade et qu’il fallait la soigner, psychologiquement de préférence, le morale des ménages en tour de passe-passe commode pour masquer la dynamique des politiques d’inégalités conduites jusque là.
La faillite est donc totale, en particulier de cette prétendue méritocratie républicaine qui renvoie chacun à son prétendu échec et les chômeurs à leur prétendue paresse quand le chômage de masse s’est installé en France dès le début des années 1980 !
La précarité, la pauvreté, qui sont l’empreinte de la mondialisation des échanges, a conduit à la polarisation de la structure sociale française et de son marché du travail, avec d’un côté quelques fonctions hautement qualifiés et de l’autre, l’immense réservoir des gagne-pain sous-qualifiés, rémunérés à la limite de la décence.
La société de l’intelligence, tant vantée et attendue dans les années 80, n’aura ouvert la voie qu’à la précarité de masse. C’est du reste ce que constate l’OCDE, préconisant de dépenser moins d’argent encore dans l’éducation, puisque dans leur immense majorité, les jeunes de demain n’auront besoin d’aucune formation pour survivre.
Voilà ce qu’est notre réalité politico-économique. 30 années de reproduction sociale. Une génération sacrifiée, bientôt deux. Les derniers rapports de l’OIT (organisation International du Travail) vont dans ce sens : massivement, les jeunes de demain seront chômeurs et le resteront. Et en Europe, où déjà l’Espagne compte 50% de jeunes adultes au chômage, la France figure parmi les plus mauvais élèves, sans que cela préoccupe vraiment, sinon au replâtrage à la marge…
e destin au berceau : Inégalités et reproduction sociale, Camille Peugny, éd. du Seuil, coll. La République des idées, mars 2013, 112 pages, 11,80 euros, ISBN-13: 978-2021096088.




 Assez ! L’histoire serait savoureuse s’il n’y avait autant de misère et d’injustice en France !
Assez ! L’histoire serait savoureuse s’il n’y avait autant de misère et d’injustice en France ! Souffrance au travail, harcèlement, suicide. On se rappelle l’émoi d’une société, la nôtre, découvrant soudain que le travail mutilait, blessait, tuait. Pas forcément les plus faibles, tant la précarité avait gagné de terrain et la peur occupait désormais l'essentiel de notre vie sociale.
Souffrance au travail, harcèlement, suicide. On se rappelle l’émoi d’une société, la nôtre, découvrant soudain que le travail mutilait, blessait, tuait. Pas forcément les plus faibles, tant la précarité avait gagné de terrain et la peur occupait désormais l'essentiel de notre vie sociale. Le travail se déploie certes dans le monde objectif, mais il se déploie aussi dans le monde subjectif, celui précisément de la reconnaissance et de la construction de l’identité.
Le travail se déploie certes dans le monde objectif, mais il se déploie aussi dans le monde subjectif, celui précisément de la reconnaissance et de la construction de l’identité.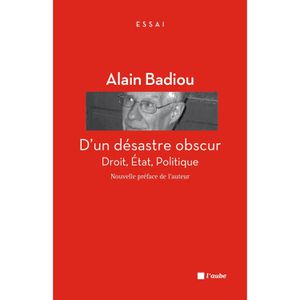 L’essai date de 1991, mais la préface est actualisée. Le point de départ de la réflexion d’Alain Badiou, c’est la chute de l’Union soviétique, en 89. Un désastre, selon lui, en ce que cette chute n’aura pas été le fruit d’une révolte populaire, mais le fait d’un effondrement intérieur. Soit-dit en passant, c’est exactement le même désastre qui pourrait bien nous menacer, tant l’effondrement de la société néolibérale sur elle-même est perceptible. L’inertie et la brutalité qui ont surgi ces dernières années au sein de l’UE plus particulièrement, rappellent pour beaucoup celles qui ont présidé à la chute de l’Union soviétique… Et tout comme dans son cas, nos dirigeants se montrent incapables de comprendre la situation et de prendre les décisions qui s’imposent, nous livrant jour après jour à l’obscur, dont nous ne connaissons certes pas encore le nom, mais dont nous percevons l’ignoble rumeur dans la formidable montée en puissance de l’islamophobie par exemple.
L’essai date de 1991, mais la préface est actualisée. Le point de départ de la réflexion d’Alain Badiou, c’est la chute de l’Union soviétique, en 89. Un désastre, selon lui, en ce que cette chute n’aura pas été le fruit d’une révolte populaire, mais le fait d’un effondrement intérieur. Soit-dit en passant, c’est exactement le même désastre qui pourrait bien nous menacer, tant l’effondrement de la société néolibérale sur elle-même est perceptible. L’inertie et la brutalité qui ont surgi ces dernières années au sein de l’UE plus particulièrement, rappellent pour beaucoup celles qui ont présidé à la chute de l’Union soviétique… Et tout comme dans son cas, nos dirigeants se montrent incapables de comprendre la situation et de prendre les décisions qui s’imposent, nous livrant jour après jour à l’obscur, dont nous ne connaissons certes pas encore le nom, mais dont nous percevons l’ignoble rumeur dans la formidable montée en puissance de l’islamophobie par exemple. A l’heure où de plus en plus de dirigeants politiques ne cessent dans le monde de remettre sur la table l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS), en particulier dans le domaine de l’éducation, prenant acte de ce que l’économie du troisième millénaire engendrera surtout des emplois précaires ne demandant aucune formation, l’OMT leur conseillant en conséquence d’alléger leurs dépenses en matière d’éducation, sans doute serait-il bon de faire le point en France sur l’échec de notre système scolaire…
A l’heure où de plus en plus de dirigeants politiques ne cessent dans le monde de remettre sur la table l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS), en particulier dans le domaine de l’éducation, prenant acte de ce que l’économie du troisième millénaire engendrera surtout des emplois précaires ne demandant aucune formation, l’OMT leur conseillant en conséquence d’alléger leurs dépenses en matière d’éducation, sans doute serait-il bon de faire le point en France sur l’échec de notre système scolaire… La crise (intentionnelle) nous dit-on, aurait démarré en 2008. Beau conte de fées, quand depuis plus de trente ans, les sociétés occidentales se sont mises à confisquer les richesses produites par le plus grand nombre au profit d’une infime minorité curatrice.
La crise (intentionnelle) nous dit-on, aurait démarré en 2008. Beau conte de fées, quand depuis plus de trente ans, les sociétés occidentales se sont mises à confisquer les richesses produites par le plus grand nombre au profit d’une infime minorité curatrice. L’ordre social est une économie de la menace.
L’ordre social est une économie de la menace. A quoi ressemblerait donc une société sans genre et sans sexe ?
A quoi ressemblerait donc une société sans genre et sans sexe ? A l’heure où l’Agence Française de sécurité sanitaire vient de remettre son rapport sur l’impact de la pollution atmosphérique, révélant que toutes les villes étudiées en France présentaient des valeurs de particules et d’ozone supérieures aux valeurs guides recommandées par l’Organisation Mondiale de la santé, peut-être serait-il temps de prendre enfin en compte le problème au sommet de l’Etat, d’autant qu’il se révèle particulièrement dramatique au regard des menaces qui pèsent sur la santé des enfants.
A l’heure où l’Agence Française de sécurité sanitaire vient de remettre son rapport sur l’impact de la pollution atmosphérique, révélant que toutes les villes étudiées en France présentaient des valeurs de particules et d’ozone supérieures aux valeurs guides recommandées par l’Organisation Mondiale de la santé, peut-être serait-il temps de prendre enfin en compte le problème au sommet de l’Etat, d’autant qu’il se révèle particulièrement dramatique au regard des menaces qui pèsent sur la santé des enfants. Plutôt que de rester les corps souffrants de l’antique rébellion, devenons des corps opaques à cette lecture triviale de notre être que le capitalisme, dans sa mouture néolibérale, propose : entrepreneurs de désirs lisibles en termes d’une dépense économique qui seule déterminerait la valeur de leur être…
Plutôt que de rester les corps souffrants de l’antique rébellion, devenons des corps opaques à cette lecture triviale de notre être que le capitalisme, dans sa mouture néolibérale, propose : entrepreneurs de désirs lisibles en termes d’une dépense économique qui seule déterminerait la valeur de leur être… L’expérience nouvelle, c’est déserter l’espace marchand, y compris celui de la culture, pour rendre nos événements publics, illimités, in-assignables. C’est inventer des modèles économiques précaires, incertains, où tenter néanmoins de tisser des résonances et prendre le risque de les déployer le plus largement possible.
L’expérience nouvelle, c’est déserter l’espace marchand, y compris celui de la culture, pour rendre nos événements publics, illimités, in-assignables. C’est inventer des modèles économiques précaires, incertains, où tenter néanmoins de tisser des résonances et prendre le risque de les déployer le plus largement possible.