 Les dirigeants européens ne peuvent plus masquer la réalité de cette Europe dont ils avaient pris tant de soin à travestir les vrais enjeux, dessinant au passage une géographie morale du continent en question à tout le moins insupportable, au service de la grande Finance Internationale, Goldmann Sachs en tête. Ce faisant, ils nous rappellent opportunément que cette Europe qu’ils ont voulue, eux et non nous, n’aura jamais était une histoire des Peuples européens : l’Europe aura toujours été l’affaire des Etats, une construction anti-démocratique par excellence, dont les peuples sont aujourd’hui les prisonniers.
Les dirigeants européens ne peuvent plus masquer la réalité de cette Europe dont ils avaient pris tant de soin à travestir les vrais enjeux, dessinant au passage une géographie morale du continent en question à tout le moins insupportable, au service de la grande Finance Internationale, Goldmann Sachs en tête. Ce faisant, ils nous rappellent opportunément que cette Europe qu’ils ont voulue, eux et non nous, n’aura jamais était une histoire des Peuples européens : l’Europe aura toujours été l’affaire des Etats, une construction anti-démocratique par excellence, dont les peuples sont aujourd’hui les prisonniers.
Et ce dès les origines, dans l’esprit même de son "Père" fondateur, Jean Monnet, dont la biographie mériterait d’être dépoussiérée ! Un Monnet qui sut en effet dès le début ne s’entourer que de technocrates pour penser notre destin. Car même si dans le projet de la CECA, la base sociale de cette Europe fut élargie à ces couches que l’on avait ignorées jusque là dans les sphères de pouvoir, les paysans, les ouvriers, l’Europe resta la grande affaire des nantis et… des américains. Qui se rappelle en effet que notre cher Jean Monnet était un proche de la famille Dulles, dont Alan fut le fondateur de la CIA ? Qui se rappelle ce Monnet, proche des sphères du pouvoir américain, côtoyant dans les années 50 le groupe Harvard chargé de réfléchir une construction européenne favorable aux Etats-Unis ? Qui se rappelle le jeune banquier accomplissant toute sa carrière dans la finance internationale, soupçonneux des exigences démocratiques des peuples et ne songeant qu’à se délester au plus vite des forces sociales tout comme des frontières nationales pour mieux asseoir sa vision capitaliste de l’Europe ? Peu attachée au cadre de l’Etat Nation, cette carrière paraît aujourd’hui emblématique du destin européen que les banquiers nous ont fabriqué. Une Europe méprisant les électorats populaires, une Europe dictant ses conditions aux Etats membres, une Europe construite autour de la notion d’allégeance plutôt que de consensus, relevant non pas de la participation civique mais de l’adhésion coutumière. Une Europe dont la force repose sur la faiblesse politique de ses peuples. Et plus que jamais, une Europe autoritaire exaltant la suspicion de Monnet, cherchant toujours à contourner les volontés populaires dans son processus de constitution. Une Europe qui se fabrique avec un faible soutien social, tour de force administratif que les faucons américains nous envient tant elle est un modèle du genre, pour des régimes que leur démocratie embarrasse désormais.
Et pour calmer toute fronde anti-européenne, une Europe au sein de laquelle les élites volent au secours des banquiers pour convoquer une longue et belle histoire cousue de fil blanc. Une histoire qui nous raconte par exemple que cette Europe est née de deux grandes unifications, chrétienne puis celle, humaniste, de la Renaissance, en oubliant volontairement que dans la réalité, chacune de ces unifications s’est conclue par l’émergence de forces centripètes qui ont produit beaucoup de résistances et de diversifications, laissant surgir de nouvelles singularités qui mirent chaque fois à mal cette fameuse unification européenne décidée par le haut. Il existe ainsi en Europe, en permanence, des mécanismes qui produisent des différences et font obstacle aux mécanismes d’unification.
 Jean Monnet ne l’ignorait pas, lui, qui chercha toute sa vie à faire sortir la question européenne du champ symbolique pour la faire entrer dans celui des techniques politiques.
Jean Monnet ne l’ignorait pas, lui, qui chercha toute sa vie à faire sortir la question européenne du champ symbolique pour la faire entrer dans celui des techniques politiques.
Mais aujourd’hui, on est arrivé à la limite de ce processus qui faisait l’Europe à l’insu des européens.
Le danger est double du reste, celui de voir éclore une technocratie toute puissante, tout comme celui de voir un imaginaire social réactionnaire fleurir sur les décombres de cette Europe stipendiée, laissant s’épanouir des replis identitaires des plus funestes.
Face à ce double danger, qui aura le courage, en particulier, d’évoquer le rôle de l’immigration dans le processus de construction de l’Europe ?
Qui aura le courage de dépasser les aspects purement démographiques de cette question, qui n’expliquent que partiellement le rôle joué par ces groupes face à leur communauté d’accueil ? Qui saura affirmer que les aspects économiques sont insuffisants à nous permettre de penser cette question ?
Qui saura dire que les aspects politiques témoignent le plus souvent de constructions négatives destinées à provoquer l’infléchissement des politiques budgétaires des pays receveurs, via l’instrumentalisation éhontée de cette question ?
Qui saura affirmer les aspects culturels nous permettant une meilleure compréhension de l’immigration comme processus d’intégration européenne ?.
Qui saura montrer que l’émigration reste le révélateur fort des transformations et des avancées sociales dans un pays donné ?
Qui saura écrire en somme cette histoire, en prenant appui sur celle, comparative, de la circulation des œuvres littéraires et de leurs traductions, seule histoire culturelle au fond, permettant d’écrire une vraie histoire de l’Europe ? Au lieu de nous infliger de nouveau un débat honteux sur la question du droit de vote des immigrés ! --joël jégouzo--.
Photos : De gauche à droite, Jean Monnet, John Foster Dulles, Kirk Spieremburg, Dwight D. Eisenhower, David Bruce, Franz Etzel, William Rand. A Washington, Juin 1953.



 La volonté du peuple, affirme-t-on, ne peut , dans les démocraties modernes, s’exprimer que sous une forme politique. Le suffrage universel en serait même l’ultime et seule expression acceptable. Or, l’histoire a (trop) largement démontré que le suffrage universel ne pouvait établir une identité entre la volonté des gouvernements et la volonté des gouvernés.
La volonté du peuple, affirme-t-on, ne peut , dans les démocraties modernes, s’exprimer que sous une forme politique. Le suffrage universel en serait même l’ultime et seule expression acceptable. Or, l’histoire a (trop) largement démontré que le suffrage universel ne pouvait établir une identité entre la volonté des gouvernements et la volonté des gouvernés. L’Etat français est une Dictature moderne, subordonnant le politique à l’économique, c’est-à-dire suspendant l’ordre politique pour l’assujettir à la décision privée (celle des banquiers).
L’Etat français est une Dictature moderne, subordonnant le politique à l’économique, c’est-à-dire suspendant l’ordre politique pour l’assujettir à la décision privée (celle des banquiers). Comment concevoir un monde juste ? Surtout à l’heure où les idéologies de la justice semblent avoir fait faillite…
Comment concevoir un monde juste ? Surtout à l’heure où les idéologies de la justice semblent avoir fait faillite… Voici une histoire dont il existe peu d’échos en France : comment la Révolution industrielle s’est débarrassée de ses exclus, en Angleterre. Au fond, un exemple pour nous qui sommes entrés dans une ère de stigmatisation des plus démunis… Mais l’intérêt de l’exemple tient aussi au fait que, idéologiquement, les marques du discours sont restées les mêmes : déjà, contre toute évidence, il s’agissait de dénoncer une prétendue paresse et de faire des pauvres les ennemis de la nation. L’idée est demeurée, que le système d’allocations accordés aux pauvres ne fait qu’encourager l’oisiveté et qu’il n’est de la sorte qu’une incitation au vice…
Voici une histoire dont il existe peu d’échos en France : comment la Révolution industrielle s’est débarrassée de ses exclus, en Angleterre. Au fond, un exemple pour nous qui sommes entrés dans une ère de stigmatisation des plus démunis… Mais l’intérêt de l’exemple tient aussi au fait que, idéologiquement, les marques du discours sont restées les mêmes : déjà, contre toute évidence, il s’agissait de dénoncer une prétendue paresse et de faire des pauvres les ennemis de la nation. L’idée est demeurée, que le système d’allocations accordés aux pauvres ne fait qu’encourager l’oisiveté et qu’il n’est de la sorte qu’une incitation au vice… Le sentiment général était donc qu’il fallait apporter une réponse à la mesure de ce défi pour la société anglaise, menacée d’implosion. Le système prévoyait que les pauvres percevraient un revenu minimum à défaut d’un emploi qui n’existait pas, voire des allocations permettant de compléter leur salaire quand celui-ci était trop bas. La "quantité de soulagement" à prodiguer était calculée sur le prix d'un gallon de pain et le nombre d’enfants à charge du travailleur. Cette mesure conduisit Malthus à penser que l’indexation sur le nombre d’enfants, compte tenu que les pauvres constituaient généralement des familles nombreuses, était un mauvais calcul et qu’il fallait au contraire baisser les allocations proportionnellement à ce nombre, afin de ne pas les inciter à nourrir une famille trop importante… L'idée d'un revenu minimum d'insertion, offert en farine, pain ou argent, n’était certes pas nouvelle. Ce qui était nouveau, c’était qu’il s’agissait d’une mesure provisoire désormais :
Le sentiment général était donc qu’il fallait apporter une réponse à la mesure de ce défi pour la société anglaise, menacée d’implosion. Le système prévoyait que les pauvres percevraient un revenu minimum à défaut d’un emploi qui n’existait pas, voire des allocations permettant de compléter leur salaire quand celui-ci était trop bas. La "quantité de soulagement" à prodiguer était calculée sur le prix d'un gallon de pain et le nombre d’enfants à charge du travailleur. Cette mesure conduisit Malthus à penser que l’indexation sur le nombre d’enfants, compte tenu que les pauvres constituaient généralement des familles nombreuses, était un mauvais calcul et qu’il fallait au contraire baisser les allocations proportionnellement à ce nombre, afin de ne pas les inciter à nourrir une famille trop importante… L'idée d'un revenu minimum d'insertion, offert en farine, pain ou argent, n’était certes pas nouvelle. Ce qui était nouveau, c’était qu’il s’agissait d’une mesure provisoire désormais :  Récapitulons : les pauvres reçoivent une allocation à titre provisoire, qui leur est supprimée s’ils ne retrouvent pas un emploi (mais il n’y en a pas, ça tombe bien…). S’ils en trouvent, le système d’allocation est maintenu dans le cas où le salaire est inférieur au montant de l’allocation (!). L’effet pervers immédiat fut l’effondrement des salaires à la campagne. On passa du coup de l’existence d’une masse d’indigents à celle d’une classe de travailleurs pauvres (c’est le cas en France aujourd’hui). Les travailleurs en question, exploités sans vergogne, ne tardaient en outre jamais à épuiser leurs forces dans ce champ clos qu’était devenu l’emploi (presque) salarié et, usés avant l’âge, devenaient inemployables. La paroisse devait alors en supporter les conséquences. Bien évidemment, les propriétaires terriens les plus taxés par l’impôt sur le soulagement des pauvres se liguèrent pour n’avoir plus à le payer. On mit en place des procédures sophistiquées de votes dans les paroisses, destinés à calculer et recalculer de mois en mois le montant du taux d’indemnisation des pauvres. On distingua alors les pauvres méritants (vestries), des "undeserving" — les inemployables. Ce dernier groupe ne reçut bientôt plus de subsides. La Loi, après avoir cassé définitivement le marché du travail, avait jeté à la rue une masse considérable de salariés précaires, amplifiant en retour la spirale de la paupérisation. Ce, jusqu’en 1815, où le malaise, à la suite de la guerre contre les français, provoqua de vifs désordres civils. Une dépression industrielle l’amplifia. Dans le Sud rural, la bonne vieille charité individuelle fit de nouveau surface. On considéra qu’elle ne faisait qu’encourager l’oisiveté et le vice. On se mit alors à penser que ce système d’allocations n’était en fin de compte qu’une sorte d’encouragement, voire de crédit accordé à la paresse. Les enquêtes parlementaires de 1832 à 1834 s’en font largement l’écho. Leurs conclusions furent toutes d’affirmer qu’on devait mettre fin à ce système. Le nord industriel, lui, s’inquiéta beaucoup : malgré l’injonction faite aux pauvres de ne pas quitter leur paroisse, il en circulait beaucoup sur les routes. De grandes campagnes anti-pauvres y furent désormais menées :
Récapitulons : les pauvres reçoivent une allocation à titre provisoire, qui leur est supprimée s’ils ne retrouvent pas un emploi (mais il n’y en a pas, ça tombe bien…). S’ils en trouvent, le système d’allocation est maintenu dans le cas où le salaire est inférieur au montant de l’allocation (!). L’effet pervers immédiat fut l’effondrement des salaires à la campagne. On passa du coup de l’existence d’une masse d’indigents à celle d’une classe de travailleurs pauvres (c’est le cas en France aujourd’hui). Les travailleurs en question, exploités sans vergogne, ne tardaient en outre jamais à épuiser leurs forces dans ce champ clos qu’était devenu l’emploi (presque) salarié et, usés avant l’âge, devenaient inemployables. La paroisse devait alors en supporter les conséquences. Bien évidemment, les propriétaires terriens les plus taxés par l’impôt sur le soulagement des pauvres se liguèrent pour n’avoir plus à le payer. On mit en place des procédures sophistiquées de votes dans les paroisses, destinés à calculer et recalculer de mois en mois le montant du taux d’indemnisation des pauvres. On distingua alors les pauvres méritants (vestries), des "undeserving" — les inemployables. Ce dernier groupe ne reçut bientôt plus de subsides. La Loi, après avoir cassé définitivement le marché du travail, avait jeté à la rue une masse considérable de salariés précaires, amplifiant en retour la spirale de la paupérisation. Ce, jusqu’en 1815, où le malaise, à la suite de la guerre contre les français, provoqua de vifs désordres civils. Une dépression industrielle l’amplifia. Dans le Sud rural, la bonne vieille charité individuelle fit de nouveau surface. On considéra qu’elle ne faisait qu’encourager l’oisiveté et le vice. On se mit alors à penser que ce système d’allocations n’était en fin de compte qu’une sorte d’encouragement, voire de crédit accordé à la paresse. Les enquêtes parlementaires de 1832 à 1834 s’en font largement l’écho. Leurs conclusions furent toutes d’affirmer qu’on devait mettre fin à ce système. Le nord industriel, lui, s’inquiéta beaucoup : malgré l’injonction faite aux pauvres de ne pas quitter leur paroisse, il en circulait beaucoup sur les routes. De grandes campagnes anti-pauvres y furent désormais menées :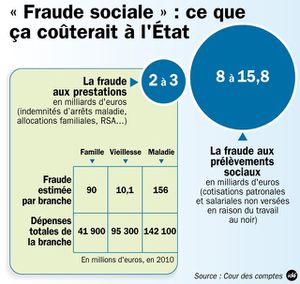 Et si on rouvrait les camps français ?
Et si on rouvrait les camps français ? Toujours selon cette même étude, les ingénieurs vont plus souvent chez le dentiste que les ouvriers. La proportion de cadres supérieurs qui sont allés chez le dentiste lors de cette enquête est même deux fois plus élevée que celle des ouvriers. C’est que chez les ouvriers, le suivi médical fait défaut. Faute de disposer d’une complémentaire. Toutes les études récentes montrent du reste qu’une grande partie des familles peu aisées renonceront l’an prochain à leur mutuelle…
Toujours selon cette même étude, les ingénieurs vont plus souvent chez le dentiste que les ouvriers. La proportion de cadres supérieurs qui sont allés chez le dentiste lors de cette enquête est même deux fois plus élevée que celle des ouvriers. C’est que chez les ouvriers, le suivi médical fait défaut. Faute de disposer d’une complémentaire. Toutes les études récentes montrent du reste qu’une grande partie des familles peu aisées renonceront l’an prochain à leur mutuelle… On le voit avec le contournement du référendum français, la confiscation du référendum en Grèce, l’arrivée au pouvoir des banquiers en Italie. On le voit à l’étude attentive des liens qui se tissent ici et là à la faveur de cette pseudo crise : Mario Draghi, le nouveau président de la Banque centrale européenne, proche de Mario Monti, le président désigné du Conseil Italien, proche de Lucas Papadémos, le nouveau Premier ministre grec, tous les trois appointant à la banque d’affaires américaine Goldman Sachs, qui ne cesse d’étendre en Europe son réseau d'influence.
On le voit avec le contournement du référendum français, la confiscation du référendum en Grèce, l’arrivée au pouvoir des banquiers en Italie. On le voit à l’étude attentive des liens qui se tissent ici et là à la faveur de cette pseudo crise : Mario Draghi, le nouveau président de la Banque centrale européenne, proche de Mario Monti, le président désigné du Conseil Italien, proche de Lucas Papadémos, le nouveau Premier ministre grec, tous les trois appointant à la banque d’affaires américaine Goldman Sachs, qui ne cesse d’étendre en Europe son réseau d'influence. Penser collectivement : non comme savoir mais comme lucidité qui contraint à prendre soin des hommes autant que du monde. Car tout comme la philosophie, la politique est un exercice de lucidité, au terme duquel il ne s’agit pas de voir ce qui est mais ce qui institue le bon fonctionnement de la cité, dont l’être humain est la finalité, non les moyens. De ce point de vue, force est d’admettre que nous connaissons, en France, la forme la moins enviable du libéralisme. Un libéralisme qui ne cesse de nous faire le coup du discours moral toujours réactualisé sur la nécessité d’introduire un peu de morale dans la gestion du pouvoir, quand déjà le XVIème siècle posait cette même question de fixer des limites morales au pouvoir des gouvernements ! Quand depuis des siècles les libéraux ne prétendent cesser d’y songer, au nom du Bien Commun !
Penser collectivement : non comme savoir mais comme lucidité qui contraint à prendre soin des hommes autant que du monde. Car tout comme la philosophie, la politique est un exercice de lucidité, au terme duquel il ne s’agit pas de voir ce qui est mais ce qui institue le bon fonctionnement de la cité, dont l’être humain est la finalité, non les moyens. De ce point de vue, force est d’admettre que nous connaissons, en France, la forme la moins enviable du libéralisme. Un libéralisme qui ne cesse de nous faire le coup du discours moral toujours réactualisé sur la nécessité d’introduire un peu de morale dans la gestion du pouvoir, quand déjà le XVIème siècle posait cette même question de fixer des limites morales au pouvoir des gouvernements ! Quand depuis des siècles les libéraux ne prétendent cesser d’y songer, au nom du Bien Commun ! Il faut cesser de croire qu’il n’existe pas d’Europe politique. L’Union Européenne EST un régime politique. Et le pire qui soit, celui que les faucons américains nous envient, laboratoire du plus fabuleux rapt des valeurs démocratiques modernes qui soit, un régime néo-libéral autoritaire, articulé par le mépris des classes dirigeantes à l’égard des peuples européens. Derniers exemples en date : les grecs n’auront pas droit à leur référendum, tandis que les italiens verront s’accomplir le règne des experts, sans qu’aucun débat démocratique n’ait jamais permis d’en décider.
Il faut cesser de croire qu’il n’existe pas d’Europe politique. L’Union Européenne EST un régime politique. Et le pire qui soit, celui que les faucons américains nous envient, laboratoire du plus fabuleux rapt des valeurs démocratiques modernes qui soit, un régime néo-libéral autoritaire, articulé par le mépris des classes dirigeantes à l’égard des peuples européens. Derniers exemples en date : les grecs n’auront pas droit à leur référendum, tandis que les italiens verront s’accomplir le règne des experts, sans qu’aucun débat démocratique n’ait jamais permis d’en décider. Observez, avec Perry Anderson, l’historien le plus averti de cette Europe stipendiée, scrutant au scalpel les institutions de l’UE pour en dégager le sens profond, observez comment s’équilibrent les forces institutionnelles au sein de cette UE : une Commission Européenne, son exécutif, où siègent des fonctionnaires nommés par les Etats membres, sans aucun mandat démocratique donc. Un Conseil des Ministres transformé en instance législative délibérant secrètement, un Conseil européen des chefs de gouvernement convoquant les récalcitrants, les maladroits, pour leur dicter ses décisions…
Observez, avec Perry Anderson, l’historien le plus averti de cette Europe stipendiée, scrutant au scalpel les institutions de l’UE pour en dégager le sens profond, observez comment s’équilibrent les forces institutionnelles au sein de cette UE : une Commission Européenne, son exécutif, où siègent des fonctionnaires nommés par les Etats membres, sans aucun mandat démocratique donc. Un Conseil des Ministres transformé en instance législative délibérant secrètement, un Conseil européen des chefs de gouvernement convoquant les récalcitrants, les maladroits, pour leur dicter ses décisions… Il faut cesser de nous faire croire qu’on pourrait moraliser les milieux financiers, mieux, qu’ils pourraient, par eux-mêmes, le vouloir un jour. Déjà, en 1914, la finance dévoilait son seul vrai visage, qui est celui du dividende à tout prix, du bénéfice à n’importe quel prix, celui de millions de morts, par exemple…
Il faut cesser de nous faire croire qu’on pourrait moraliser les milieux financiers, mieux, qu’ils pourraient, par eux-mêmes, le vouloir un jour. Déjà, en 1914, la finance dévoilait son seul vrai visage, qui est celui du dividende à tout prix, du bénéfice à n’importe quel prix, celui de millions de morts, par exemple… Ou bien encore : à la veille de lancer son propre emprunt pour la défense nationale, le gouvernement français autorisa deux emprunts turcs – dont les Turcs feront le meilleur usage aux Dardanelles… Mieux, si l’on peut dire : une partie de cet emprunt servie à offrir une ristourne à l’Allemagne, débitrice de la Turquie, de sorte que la France se mit à rembourser littéralement les créances de son ennemi direct…
Ou bien encore : à la veille de lancer son propre emprunt pour la défense nationale, le gouvernement français autorisa deux emprunts turcs – dont les Turcs feront le meilleur usage aux Dardanelles… Mieux, si l’on peut dire : une partie de cet emprunt servie à offrir une ristourne à l’Allemagne, débitrice de la Turquie, de sorte que la France se mit à rembourser littéralement les créances de son ennemi direct…