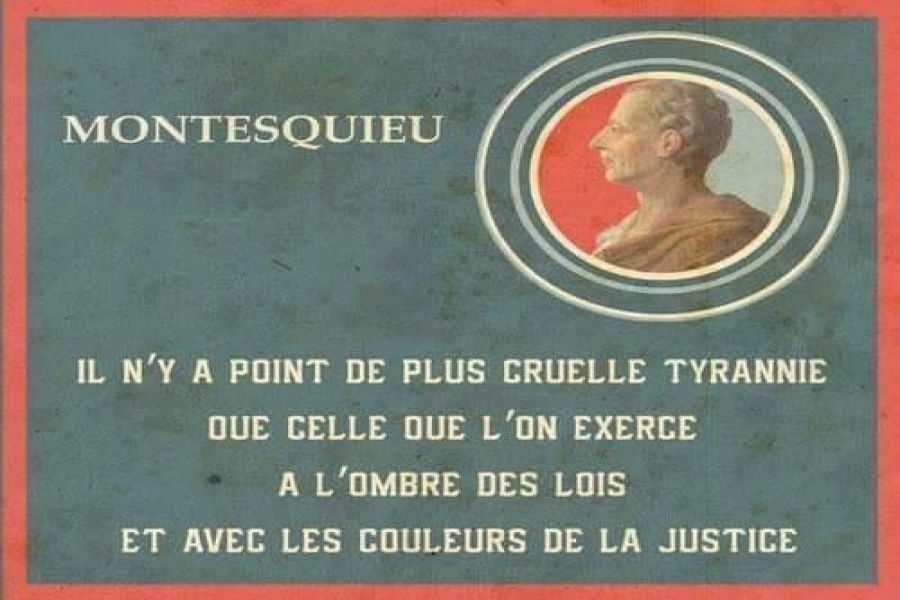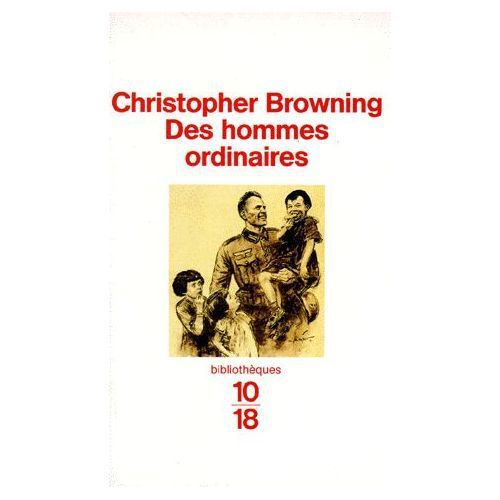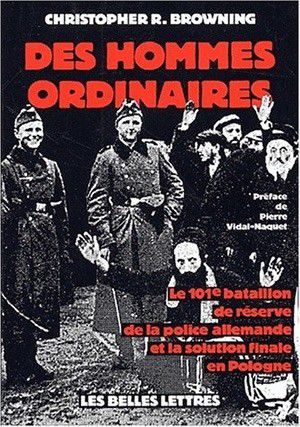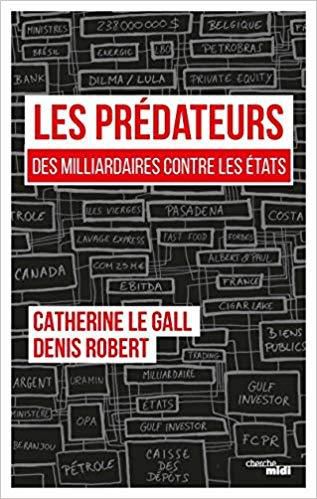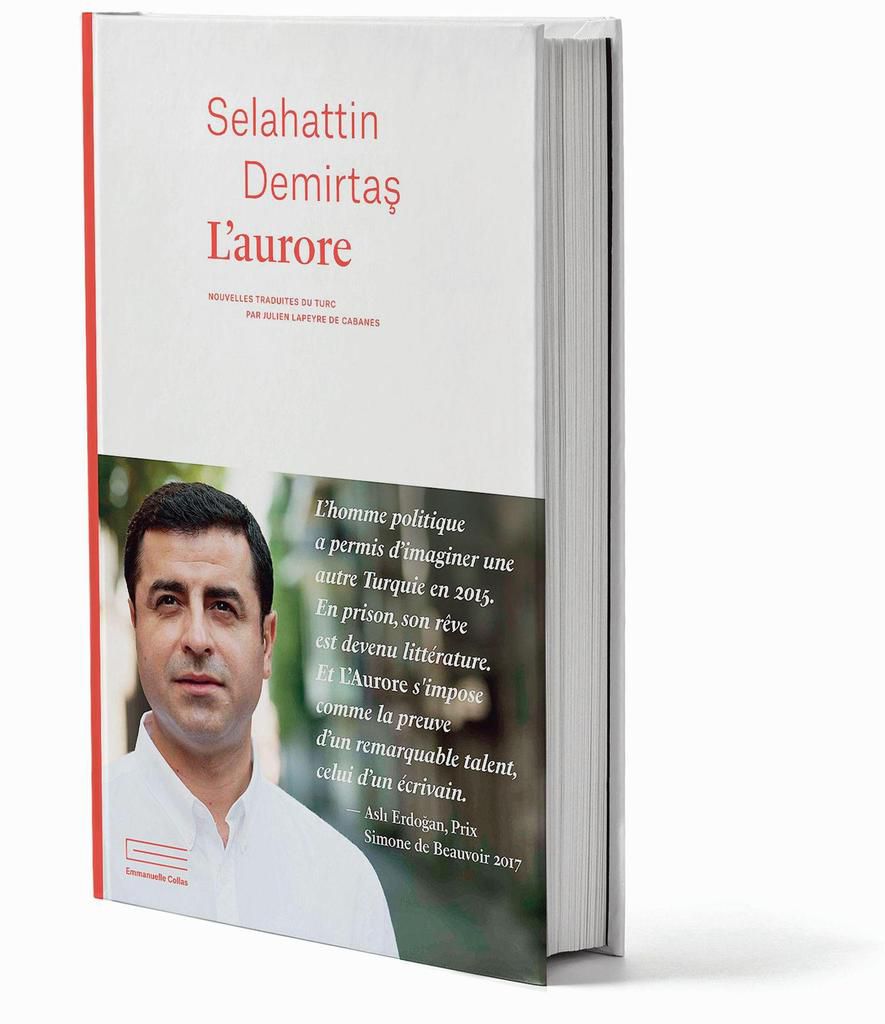Histoire, méthode et organisation des services secrets en France, des origines à nos jours… L’ouvrage est ambitieux en si peu de pages et pourtant réussi à bien des égards son pari, nous offrant une image finalement assez homogène des causes et des raisons réelles du déploiement des services de renseignement en France. Un service public, rappelons-le… Encadré donc par le législateur, qui ces dernières années lui a défini sept finalités, en rajoutant une dernièrement, discutable, celle de la « prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique » (article L811-2, Livre VIII du code de sécurité intérieure, Loi du 24 juillet 2015). Imaginez ! Il semble du reste que nous n’en ayons pas pris la pleine conscience, cette finalité pointant rien moins que les libertés publiques ! Ce qui revient en fin de compte à inscrire dans le cadre de la loi des Lois d’exception et à même niveau, la répression de la contestation sociale et celle du terrorisme international... Cela dit, la longue histoire du renseignement français que nous raconte l’auteur nous révèle finalement que depuis sa création, le renseignement a toujours eu pour mission première, en France, celle de la surveillance du Peuple français ! Dès Louis XIV, les agents du renseignement se préoccupaient davantage des intrigues de la Cour que des menaces extérieures qui pesaient sur le royaume… La naissance d’une réflexion sur la sécurité nationale, que l’auteur date du 24 août 1665, a d’abord été conditionnée par les affaires politiques du royaume. Ainsi, le paysage administratif du renseignement, dès ses origines, aura-t-il contraint nos espions à surveiller les sujets français en vue de faciliter leur répression. Bonaparte poursuivit dans le même esprit de méfiance du Peuple, en renforçant les missions de police du renseignement. On ficha ainsi, sous la houlette des préfets de police et pour satisfaire une cause très peu nationale, quartier par quartier dans Paris, les séditieux ou jugés tels, les contestataires susceptibles de « troubler l’ordre public ». Dans la foulée, avec le zèle qu’on leur connaît, les préfets en profitèrent pour mettre au point un maillage très serré de surveillance de la population, dont on ne cessait de se défier. Louis-Napoléon Bonaparte institua même une « police des opinions », nos futurs RG, lesquels, dès leur création en 1911 participèrent au… maintien de l’ordre ! Et sous Vichy, leur mission explicite devint celle de la répression de la Résistance. En 1967, toujours les mêmes, se virent confier le renseignement politique, officiellement clos en 1944, du moins pour son volet surveillance des partis politiques, ce dont il est permis de douter. En fin de compte, ce à quoi l’ouvrage ouvre, c’est à la vision d’un service dévoyé de ses missions pour seconder les intérêts d’une caste, d’une classe, d’un groupe social sinon d’un clan, qui a toujours surveillé avec mépris et anxiété le plus grand nombre, toujours capable de menacer ses intérêts privés, et qui n’a cessé administrativement de restreindre les libertés publiques pour mieux parvenir à ses fins… D’année en année en effet, ce à quoi on assiste, c’est au renforcement d’un arsenal répressif sans pareil dans le monde dit "libre"…
Le Renseignement, Christophe Soullez, Histoire, méthodes et organisation des services secrets, éditions Eyrolles, coll. Pratique / Histoire, septembre 2017, 10 euros, ean : 9782212565843.